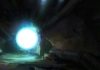LE PACTE
Les grandes douleurs sont muettes…
Quand John Hanlon a rencontré Josh Barett pour la première fois, il venait d’avoir vingt ans et débutait sa carrière de journaliste au «The Providence Journal». Il venait de se marier avec Anna et ils s’étaient installés tous les deux dans un petit appartement à Providence dans l’état de Rhode Island.
Au journal, comme il débutait, on lui avait confié une enquête afin de le tester. Son patron, Jerry Marshall lui avait demandé de faire un papier sur les conditions de détention au pénitencier Antony P. Travisono à Cranston city, à quelques kilomètres de Providence. Il avait carte blanche et il devait rendre sa copie une semaine plus tard. Ses frais étaient payés et l’établissement pénitentiaire avait accepté l’idée d’une enquête.
Le job excitait Josh et il comptait bien impressionner son patron avec l’article qu’il allait écrire.
En rentrant après sa première journée de travail, il avait partagé son enthousiasme avec Anna et ils avaient dignement arrosé l’événement.
Anna avait terminé ses études de droit et, son diplôme d’avocate en poche, elle cherchait désormais un cabinet pour débuter sa carrière. Anna avait déjà reçu trois réponses favorables et les rendez-vous étaient pris pour des entretiens la semaine suivante.
On était en juin deux mille dix-neuf et la vie leur souriait.
Le lendemain matin, John partait en direction de Cranston, muni de son bloc-notes Rhodia format A4 et de son PC portable, rangé dans sa sacoche de transport rembourrée.
En arrivant vers neuf heures devant l’édifice aux murs rouges, il avait ressenti une forte appréhension et s’était senti tout petit devant le monument austère.
La veille, avant de rejoindre Anna au lit, il avait consulté le Net pour se renseigner et avait trouvé des éléments pour débuter son enquête: le pénitencier avait été ouvert en mille neuf cent quatre-vingt cinq et avait une capacité de mille cent dix-huit détenus. Il s’agissait d’un établissement de sécurité maximale. Il se doutait qu’à l’intérieur, ce ne serait pas plus réjouissant qu’à l’extérieur et que les pensionnaires ne devaient pas être des enfants de chœur !
Avant de sonner à la porte, et sous l’œil des caméras, il avait pris une grande inspiration et avait prié sa bonne étoile de bien vouloir se pencher un peu sur lui, là et maintenant.
Une voix rocailleuse et déformée lui avait demandé, à travers un interphone le but de sa visite et il avait exhibé sa carte de presse et décliné son identité: «John Hanlon du Providence journal, j’ai rendez-vous avec le directeur.»
La lourde porte s’était ouverte et John était, pour la première fois de sa vie, entré dans ce microcosme carcéral qui allait chambouler son existence ainsi que ses certitudes les plus ancrées…
On l’avait fouillé, fait vider ses poches et donné un badge «visiteur» qu’il devait garder durant toute la durée de son séjour.
Deux gardiens l’avaient accompagné et guidé jusqu’au bureau du directeur: Brian Taggart, un type grisonnant aux cheveux très courts, imposant, très grand, musclé, et au regard bleu métal qui mettait les gens mal à l’aise.
John avait été surpris par la sobriété du bureau du directeur. Aucune décoration, pas de plante verte. Un large bureau en bois clair, une armoire dans le même ton et un fauteuil présidentiel à roulettes revêtu de cuir fauve. Sur le bureau, à sa gauche, un téléphone, au centre devant lui, un sous-main sur lequel reposait un PC portable ouvert et sur sa droite, des piles de dossiers. Et devant le bureau, deux chaises visiteurs en bois sans aucun rembourrage pour l’assise. John s’était fait la remarque que le directeur ne devait pas aimer les entretiens trop longs…
En apercevant John encadré par deux gardiens, Taggart avait froncé les sourcils, le temps de scruter le nouvel arrivant qui pénétrait dans son antre, puis il s’était décontracté et avait souri en devinant l’inconfort de son visiteur: «Hanlon, je présume ? John Hanlon !
– Oui Monsieur, du Providence journal.
– Bien ! Je vous souhaite la bienvenue. Jerry, votre patron m’a parlé de vous. Brian Taggart, enchanté. Venez donc vous assoir.
– Merci.
– Bien, dites-moi, Hanlon, il paraît que vous êtes quelqu’un d’ambitieux avec un fort potentiel, si j’en crois mon ami Jerry.
– S’il pense vraiment ça de moi, j’en suis flatté.
– Soit ! Il vous a donc demandé d’écrire un papier sur mon établissement.
– C’est ça. Sur les conditions de détention.
– Excellente idée ! Le pénitencier Antony P. Travisono, que j’ai l’honneur de diriger n’est pas très vieux, il date de 1985 et il a toujours été très bien entretenu. Ici, c’est clair, spacieux et la cantine est plutôt bonne. Vous pourrez vous en rendre compte en visitant le site.
– A vous entendre, on pourrait croire que vous gérez un camp de vacances…
– Oh ! C’est l’impression que je vous donne ? Détrompez-vous, Hanlon. Ce pénitencier est un établissement de sécurité maximale. Vous devez comprendre ce que cela implique… Si les locaux sont propres et confortables, il y règne une discipline de fer.
– Je m’en doutais un peu.
– Ici nous avons de tout, sauf ce qui pourrait s’apparenter à du menu fretin. Tous les détenus sont des criminels endurcis, multirécidivistes et parmi eux, certains ont commis les pires atrocités. Des tueurs sans âme.
– Et tout ce beau monde cohabite ?
– Hanlon ! Que Dieu nous en préserve ! Non, bien sûr. Il y a un quartier pour les cas extrêmes, à part, et ceux-là ne bénéficient pas de grand-chose. Ils ne sortent de leur cellule que pour la douche et pour la promenade dans leur pré carré. On leur apporte leur nourriture, de la lecture et ils disposent d’un récepteur de télévision dans leur cellule individuelle. C’est déjà beaucoup pour cette engeance.
– Et les autres ?
– Les autres purgent une peine plus agréable: Ils ont accès à la bibliothèque, à la salle de vidéo ; ils font du sport, ils prennent leurs repas au réfectoire et ont droit aux visites. Ils peuvent même travailler s’ils le désirent ; à la blanchisserie ou aux ateliers pour y apprendre un métier. Il y a aussi une infirmerie parfaitement équipée.
– Ce n’est pas vraiment pire que dans la marine…
– Amusant… Sauf qu’il n’y a jamais d’escale, que les gardiens et la vidéo les surveillent en permanence et que s’ils enfreignent sciemment le règlement, ils filent droit au mitard pendant quelques semaines, à l’isolement. Je ne vous souhaite pas de vivre cette expérience.»
John prenait des notes sur son carnet et semblait satisfait des éléments recueillis: «Très bien, puis-je commencer la visite des locaux ?
– Mais je vous en prie. Les deux gardiens vous accompagneront durant votre séjour. Prenez votre temps, interviewez les détenus, si vous le souhaitez. Mais restez sur vos gardes quand même…»
En baissant les yeux sur sa pile de dossiers, Taggart a souri et a brandi une des chemises en question: «Et pour vous prouver que je n’exagère pas sur la qualité de mon établissement, figurez-vous que nous avons même des détenus qui refusent leur libération anticipée pour rester parmi nous. Si si…»
Alors que John avait déjà rangé ses affaires et s’apprêtait à se lever de sa chaise, ce que venait de proférer le directeur l’avait interpelé: «Vous êtes sérieux ?
– Tout ce qu’il y a de sérieux. Il s’agit de Joshua Barett. Condamné pour meurtre et incarcéré en mille neuf cent quatre-vingt cinq, peu de temps après l’inauguration du pénitencier. C’est la troisième fois qu’il refuse la proposition de libération.
– Il peut refuser ? Il en a le droit ?
– Ma foi, il est toujours sous le coup d’une condamnation et il purge sa peine de cent quarante-cinq ans d’emprisonnement… Peut-on le lui reprocher ? Ça le regarde après tout, non ? Et c’est un détenu modèle… Aucune annotation dans son dossier. Jamais de bagarre, et les autres détenus semblent l’apprécier. Un type discret, quoi. S’ils pouvaient tous être comme lui…
– Incroyable… Trois refus… Qui pourrait bien refuser une libération ? Puis-je le rencontrer ?
– Evidemment. Repassez me voir quand vous aurez terminé pour que vous me donniez votre impression.
– Sur Barett ?
– Mains non, Hanlon ! Sur l’établissement, voyons ! Allez, vous me pardonnerez, mais j’ai une tonne de paperasse à régler. Votre avis sur Barett, je vous jure… Elle est bonne celle-là !»
John est sorti du bureau du directeur et a retrouvé les deux gardiens qui attendaient, assis, chacun sur une chaise et qui semblaient s’ennuyer ferme. Il leur a demandé un entretien avec Joshua Barett. On allait le conduire dans une salle spéciale, habituellement réservée aux entretiens des avocats avec leur client, pour les moins féroces, bien sûr…
Tout en marchant, encadré par ses deux gardes du corps, il réfléchissait: « deux mille quinze moins mille neuf cent quatre-vingt-quinze… ? Trente ans ! Ce gars est enfermé depuis trente ans et il ne souhaite pas sortir ! Merde ! C’est incroyable !»
Arrivé dans la pièce où ne se trouvaient qu’une table et deux chaises, il a déposé son bloc et son pc portable qu’il a allumé. Il pensait enregistrer l’entretien et se servir de l’enregistrement comme base pour son article. Un des deux gardiens était parti chercher Barett et l’autre était resté près de John ; il semblait regretter d’avoir été choisi pour le chaperonner.
Quand Barett est entré dans ce qui maintenant et temporairement était devenu le bureau de John, c’est un petit bonhomme un peu rond, au teint pâle et aux cheveux blancs coupés courts qui est apparu. John a immédiatement remarqué l’intelligence qui pétillait dans son regard bleu clair. Barett affichait un petit sourire en coin qui devait être naturel et permanent, et il se dégageait du septuagénaire une résignation, ainsi qu’une tranquillité que rien ne pourrait jamais perturber.
John s’est rapproché du nouveau venu et a tendu sa main droite: «John Hanlon, Monsieur Barett. Enchanté.»
Le prisonnier a lancé un regard interrogateur aux deux gardes qui se sont contenté de hausser les épaules. Alors, il a serré la main tendue et s’est dirigé vers le mur du fond, près de la chaise. Il n’était ni menotté ni entravé ; ce qui faciliterait les choses, pensait John.
S’adressant aux gardiens: «Pouvez-vous nous laisser seuls, je vous prie ?»
Les gardes ont un temps froncé les sourcils, puis le plus vieux est sorti, suivi par son collègue. Une fois la porte refermée, John a invité Barett à s’assoir et il en a fait de même.
« Je suis journaliste, Monsieur Barett. Je suis venu pour écrire un article sur le pénitencier et les conditions de détention. Je dois vous avouer que si j’ai demandé à m’entretenir avec vous, c’est parce que le directeur m’a parlé de vous et qu’il m’a informé que vous aviez refusé par trois fois votre libération anticipée. Et ça, j’aimerais le comprendre, car je pense que n’importe qui, à part vous, aurait accepté de sortir d’ici à la première occasion, non ? Je souhaite enregistrer notre conversation, si vous m’y autorisez, bien sûr.»
Barett affichait toujours son sourire énigmatique. Ses yeux semblaient le scruter, l’analyser. Au bout de quelques secondes, le détenu a semblé se décontracter, il a passé un bras en arrière, par dessus le dossier de sa chaise et a replié une jambe sur l’autre. De sa main restée posée sur la table, il a commencé à tapoter en rythme de l’index la surface lisse et métallique. Son regard ne quittait pas celui de John. Puis son sourire s’est élargi et il a demandé: «Qui êtes-vous John Hanlon, jeune journaliste ? Qui êtes-vous ?
– Comment ça ?
– Ma question est simple, non ? Qui êtes-vous ?
– Qui je suis… Pourquoi devrais-je vous parler de moi ?
– Par politesse et par équité, je pense. On ne se connait pas. Vous débarquez ici et vous me faites sortir de ma cellule pour que je vous raconte ma vie dans l’intention de la publier. C’est un peu… Cavalier pour le moins. Ne trouvez-vous pas ? Que suis-je pour vous ? Une bête rare que vous comptez exhiber à travers votre article ? Aurais-je perdu à vos jeunes yeux toute humanité ? Dites-moi, John, quel genre de journaliste souhaitez-vous devenir ?
– Il y aurait différentes sortes ?
– Il y en a deux, John. Seulement deux: les fouille-merde qu’on appelle aussi des «pisse-copies» et qui sont prêts à toutes les bassesses, à vider des poubelles, prendre des photos compromettantes et qui n’hésitent pas à détruire des réputations, des familles, des existences pour se faire un nom et vendre du papier ; et il y a les autres, ceux qui investiguent, analysent et cherchent à donner de l’information utile pour instruire, renseigner, améliorer les connaissances de la population. Que souhaitez-vous devenir John ?»
Hanlon était totalement désarçonné. Il se rendait compte à quel point sa démarche avait pu offenser Barett et s’en trouvait tout honteux. Il a baissé les yeux, confus et a marmonné: «Je… Je vous présente toutes mes excuses, Monsieur Barett. J’étais persuadé que c’était une bonne idée. Mais vous avez raison. Soyez assuré que je ne voulais pas vous manquer de respect. Je comprends votre réaction ; elle est légitime. Je ne vais pas vous embêter plus longtemps, Monsieur Barett.
– Josh.
– Pardon ?
– On m’appelle Josh.
– OK. Josh. Je vais vous laisser reprendre vos activités et je vous demande de me pardonner.
– Je te pardonne John. Tu manques d’expérience, mais tu ne sembles pas être un mauvais bougre. Si tu veux savoir pourquoi j’ai refusé les propositions de libération anticipée, tu vas devoir éteindre ton PC. Tu pourras prendre des notes. Mais si tu veux me connaître, je dois aussi faire ta connaissance. Tu comprends ? Je ne suis pas du genre à raconter ma vie au premier venu… D’où ma première question: qui es-tu John ?
– Eh bien, Josh… J’ai vingt ans, j’ai toujours vécu dans l’état de Rhode Island, j’ai fait des études de journalisme et j’ai décroché mon diplôme avec mention. J’ai récemment obtenu un job à Providence. Je suis marié. Pas d’enfant. Ma femme est avocate. On vit dans un petit appartement à Providence, dans un quartier populaire sympa… Voilà qui je suis. Et vous ?
– Eh bien, John, mon appartement est plus petit que le tien et mon quartier n’est pas aussi sympa… Je plaisante.
Je suis né en quarante et j’ai grandi dans le Minnesota, à Roseville. Par chance, mon père est revenu vivant de la guerre et j’ai eu une enfance heureuse. Plus tard, je suis devenu électricien. Ensuite, j’ai rencontré Mary, une belle jeune fille rieuse qui allait devenir ma femme et ensoleiller mon existence. Nous étions heureux, pas bien riches ; mais heureux.
Au début de notre vie commune, je travaillais dans un magasin qui vendait des aspirateurs, des radios et autres appareils électriques. La vie était simple et nos besoins aussi: des vêtements, de la nourriture, de l’eau potable et l’électricité. On n’avait pas de voiture, pas de salle de bains, mais on pouvait aller au cinéma, de temps en temps. Le seul luxe qu’on avait pu se permettre à cette époque, se résumait à un poste de radio à piles. On n’a jamais eu d’enfant et on n’a jamais su si ça venait de Mary ou de moi. On s’est fait une raison et finalement, ce n’était pas si mal, la vie à deux.
En soixante-deux, j’ai réussi à me faire embaucher à la Général Electric Motors. Notre vie s’est améliorée à partir de là. J’ai été muté plusieurs fois, mais ça ne nous dérangeait pas. On a pu s’acheter une bonne voiture d’occasion, une Mercury Comet blanche et rouge. À cette époque, les voitures étaient bien plus belles que celles d’aujourd’hui. Enfin…Nous avons coulé des jours heureux… Ouais, des jours heureux… Et puis en février quatre-vingt, alors qu’on habitait à Phoenix dans l’Arizona, Mary est tombée malade. Elle a dépéri à vue d’œil et elle a beaucoup souffert, la pauvre… Bon sang ! Un cancer du pancréas… Foudroyant. Quatre mois après le diagnostic, elle me quittait. Et cinq ans plus tard, on me condamnait à la prison pour meurtre. Voilà, John, tu sais tout.
– Désolé pour votre femme, Josh. Vraiment. Mais… Pourquoi avez-vous refusé votre libération anticipée ?
– Vois-tu, John, dans ce foutu pays, quand tu arrives à mettre trois malheureux dollars de côté, on t’en pique deux. J’ai soixante-dix-neuf ans ; crois-tu que j’aurais pu trouver un job en sortant d’ici ? Et même, à l’époque de la première proposition ; avec ma petite retraite, je me serais rapidement retrouvé à la rue, ponctionné de toutes parts par l’Etat et ses impôts, les assureurs, et je n’aurais pas eu d’assurance maladie: bien trop chère ! Je n’aurais pas pu payer mes charges et on m’aurait saisi le peu que je possédais. Je suis bien mieux ici: trois repas par jour, de l’eau chaude, une bibliothèque bien fournie et une paix royale ; aussi bien avec les autres détenus qu’avec les gardiens. J’ai fait un choix. Et je ne me sens pas aussi seul que ça…
– Je comprends… Mais, vous avez dit que vous aviez été condamné pour meurtre, et vous ne m’avez pas relaté cet événement décisif de votre vie. Que s’est-il passé ?
– J’espère que tu ne m’en voudras pas John, mais je préfère ne pas en parler. Ça ne regarde personne. Je n’ai rien dit lors de mon procès, alors, ce n’est certainement pas à un inconnu que j’expliquerai ce qui s’est réellement passé ce jour-là. Tu comprends ?
– Oh ! … Oui… J’ignore totalement comment s’est déroulé votre jugement.
– Je crois que tu as mieux à faire que d’écouter les souvenirs d’un vieillard.
– Bien. Je pense que nous avons terminé. Je vous remercie Josh.
– Tu peux me tutoyer, puisque je te tutoie. OK ?
– OK, Josh. Prends soin de toi.»
John s’est levé et il a tendu la main à Barett, que ce dernier a serrée et au moment où il ouvrait la porte pour sortir, Josh a laisser échapper : «Vous croyez ? On verra…
– Pardon ?
– Non. Rien…»
John a retrouvé les deux gardiens qui faisaient les cent pas dans le couloir. L’un d’eux est allé reconduire Josh à sa cellule, et quand il est revenu quelques minutes plus tard, ils sont partis visiter le bâtiment.
Il a rédigé son article. Un papier positif en faveur de la gestion du pénitencier. Le compte-rendu était détaillé, objectif et ponctué des avis de quelques détenus. Marshall avait accueilli son travail avec circonspection, un sourcil relevé, et l’avait félicité après avoir parcouru sa prose d’un simple: «Bon travail John !»
Anna avait été embauchée dans un cabinet renommé et John se voyait confié de nouvelles enquêtes, de plus en plus intéressantes. Leur vie était bien remplie et, finalement, ils ne se voyaient pas beaucoup car ils finissaient tard le soir, et John travaillait souvent le week-end, en fonction de la nature de ses investigations. Il se donnait à fond, passionné par son boulot. Cependant, le soir, avant de s’endormir, il ne pouvait s’empêcher de repenser à Josh ; à ce qu’il lui avait dit. Quelque chose l’intriguait. Le détenu avait évoqué sa condamnation pour meurtre, mais il n’avait pas dit qu’il avait tué la victime. Et, curieusement, son incarcération ne semblait pas l’incommoder ; au contraire. Il n’avait pas parlé durant son procès ? Pourquoi ? Etrange, non ?
Plus le temps passait, plus la question s’ancrait en lui, le turlupinait ; aussi, un matin, John est allé plus tôt qu’à son habitude au journal et il a entamé des recherches dans la base de données réservée aux professionnels en tapant: «Joshua Barett» sur le clavier de l’ordinateur. Il aurait pu le faire de chez lui, sur son portable en recherchant sur le Net, mais il n’aurait pas eu tous les détails de l’affaire, ces éléments gardés, cachés au public et conservés dans la base des journaux.
Ce qu’il avait trouvé dans les archives l’avait perturbé.
Le dix-huit juillet de l’année mille neuf cent quatre-vingt-cinq, à vingt heures, le bureau du Sheriff de Roseville avait reçu un appel téléphonique pour le prévenir qu’un cadavre venait d’être découvert. L’appel venait d’un certain Joshua Barett, un quinquagénaire natif de Roseville. La victime était Bruce Scott, natif lui aussi de la petite ville du comté de Ramsey.
Quand les policiers se sont rendus sur les lieux du crime, aux abords d’un terrain vague, Josh les attendait, tranquillement assis dans sa voiture, derrière son volant. Il les a guidés jusqu’au cadavre, dans les herbes folles. L’équipe du sheriff n’a pas trouvé d’arme et le corps qui empestait le whisky ne semblait pas porter de traces de coups ; aucune blessure n’était apparente. Seule l’expression d’horreur encore figée sur le visage de la victime, ses yeux injectés de sang et ses doigts recroquevillés au bout de ses bras toujours levés devant lui orientaient les enquêteurs vers une piste criminelle. Cependant, pas de blessure, pas de marque de strangulation, ni d’arme… Juste Barett qui avait trouvé le cadavre.
Lors de l’interrogatoire, Adam Skerrit, le Sheriff avait demandé à Josh s’il connaissait la victime et oui, il connaissait bien Bruce ; ils avaient grandi ensemble à Roseville. A la question: «Comment avez-vous découvert le corps ?» Josh avait répondu qu’il avait eu l’envie de revoir l’endroit où il allait jouer avec ses amis quand il était gosse. Il était tombé sur Bruce étendu au sol et était allé immédiatement jusqu’à une cabine téléphonique pour appeler la police.
Certains articles rappelaient qu’à cette époque, des gens avaient disparu: des femmes et des enfants. La police n’avait trouvé aucune piste et la population commençait à mettre en doute les capacités de la police locale en général et celles de Skerrit en particulier. Et en ce mois de juillet, devant un cadavre, la seule chose dont disposait le Sheriff, c’était Josh. Alors, de témoin qui avait alerté les autorités, il était devenu le principal suspect, et quand le Sheriff lui avait lu ses droits, Josh avait alors prévenu qu’il ne dirait plus rien à personne ; ni maintenant, ni jamais.
D’autres articles relataient la personnalité de Bruce Scott: un garçon perturbé qui, très tôt, avait connu le placement familial et les établissements spécialisés pour mineurs, puis la prison.
Le médecin légiste n’avait absolument rien trouvé d’anormal sur le corps et avait conclu son expertise par: «probablement décédé par un arrêt cardiaque dû à une grande frayeur».
Le procès avait été mené à charge contre Josh, sans aucune preuve ; le Sheriff poussant à la charrue et Barett restant muet. L’avocat commis d’office était désespéré. Son client ne lui parlait pas et se contentait de sourire. Il avait eu beau rappeler aux jurés que le prévenu avait alerté la police et donné son nom, que ses mains ne portaient aucune trace, que le corps était exempt de toute blessure, le verdict était tombé : «Coupable !» Et une peine de cent quarante-cinq ans avait été prononcée.
A l’énoncé de la sentence, un journaliste avait écrit que Josh continuait à sourire et ne paraissait pas contrarié.
L’issue du procès avait, semble-t-il, rassuré la population et redoré le blason de Skerrit.
Depuis, les disparitions avaient cessé.
En refermant la base de données commune aux journalistes, John avait réfléchi à ce qu’il venait de lire: «Soit il avait tué Scott et tenté de camoufler son crime et… Pourquoi prévenir la police et ne pas tenter de se défendre ? Ou bien, il était innocent et son comportement était totalement incompréhensible. Il risquait la peine capitale ! Etait-il prêt à l’accepter ? Que s’était-il réellement passé ?» Une intuition s’était alors immiscée dans son esprit: «Josh était présent lors de la mort de Scott. Et il sait exactement qui l’a tué et pourquoi. Son mutisme et son prix tellement élevé doivent forcément protéger quelqu’un. Quelqu’un de cher à ses yeux. Qui ?
John avait appelé le pénitencier Antony P. Travisono pour prévenir qu’il venait pour une entrevue avec Barett, puis il avait quitté le journal pour monter dans sa voiture et il avait foncé en direction de Cranston City.
Dans le petit local qu’il connaissait déjà, John était nerveux. Il tournait en rond et réfléchissait à la manière d’aborder le sujet avec Josh, sans l’agresser. Accepterait-il de lui parler ? De lui expliquer certaines choses ? Mystère…
La porte s’est ouverte et Barett est entré. Lentement, son éternel sourire toujours aux lèvres. Il a feint la surprise: «John ! Quel plaisir ! Comment va le brillant journaliste ?
– Bonjour Josh, content de vous voir, moi aussi.
– Oh ! Nous ne sommes plus amis ? On se vouvoie ?
– Pardon Josh, nous sommes amis, bien évidemment. Tu veux bien t’assoir ?»
Barett s’est assis en adoptant une position décontractée. Hanlon a fait signe au gardien de les laisser seuls et la porte s’est refermée.
– Alors John, pourquoi es-tu là, quatre mois après notre rencontre ? Je lis tous tes articles, et tu fais du bon boulot.
– Merci Josh. Ton histoire m’a intrigué, alors j’ai fait des recherches et je voulais t’en parler. Si tu es disposé à le faire, bien sûr…
– On verra… Raconte ce que tu sais.
– Je ne sais rien, Josh. Rien du tout. Comme tout le monde. Je pense que tu as assisté à la mort de Scott et que tu ne l’as pas tué. Je crois que tu protèges celui ou celle qui l’a tué. Quelqu’un d’important pour toi ; si important que tu as accepté d’endosser son crime, et la sentence prononcée par le juge.
– Bigre ! On dirait qu’il y en a là-dedans.» Répond Josh, en posant son index contre sa tempe, amusé.
– Je me trompe ?
– Je n’ai pas dit ça. Continue…
– Si tu avais tué Scott, tu ne serais pas resté sur place, à attendre la police. Tu aurais quitté les lieux et personne n’aurait pensé à toi. Et sinon, tu te serais défendu. Tu es resté car tu étais innocent. Mais tu as assisté au meurtre et tu sais comment Scott est mort et surtout, tu sais pourquoi. Ce que tout le monde ignore…
Peux-tu me parler de Scott ? Comment l’as-tu connu ? Et qui était-il ?»
Josh s’est passé la main dans ses cheveux blancs. Il a semblé revivre des événements passés, son regard bleu plus clair que jamais, perdu dans le vague.
– Scott… Bruce Scott… Quand on était gamins, on habitait dans la même rue à Roseville. On allait dans la même école primaire. C’était une chouette époque John, celle de l’après-guerre. Il y avait du boulot et les gens étaient heureux. Quand on avait huit ans, Scott faisait partie de notre bande. On était une dizaine à vivre dans le même quartier et à se retrouver en fin d’après-midi ou les jours sans école, quand il faisait beau, pour faire du vélo ou nous cacher dans le terrain vague où on avait construit une cabane. On était insouciants et on se marrait bien. Scott était sympa et il n’était pas le dernier à raconter des histoires drôles.
Dans la bande, il y avait deux filles: Judith Connor et Samantha King. Je me souviens qu’à l’époque, j’étais secrètement amoureux de Samantha, qu’on appelait Sam ; ça me semble remonter à une éternité.
Un an plus tard, Scott a changé. Il est devenu bizarre. Il se tenait à l’écart et n’avait plus envie de rire ; pire, il était devenu menaçant et violent. On ne savait pas pourquoi.
En fait, à cette époque, son père avait été renvoyé de son travail parce qu’il s’était présenté à l’atelier complètement ivre. Il y avait eu un accident qui avait failli coûter la vie à plusieurs ouvriers. Et, la nouvelle de l’incident avait rapidement fait le tour de la ville, si bien que le père de Scott ne pouvait plus travailler nulle part. Ils auraient dû déménager, partir plus au Sud pour recommencer ; mais non. Il a sombré dans le scotch et sa femme lui a apparemment emboîté le pas dans cette descente sans fin. Et la vie de Bruce a radicalement changé, passant du statut d’enfant unique et choyé à celui d’enfant battu, humilié, rejeté et honteux. L’argent du foyer passait dans l’alcool et les cigarettes.
Je pense qu’au début de ses malheurs, Bruce s’est replié sur lui-même en gardant pour lui ce qu’il subissait. Et puis, le temps passant, il a commencé à en vouloir à ses parents, puis au monde entier. Il souffrait à chaque fois que l’un d’entre nous racontait ce qu’il vivait chez lui, sa journée d’anniversaire, ses cadeaux. Pire, quand il surprenait l’un d’entre nous se faire embrasser par sa mère, ça le rendait dingue.
Plus tard, il s’est entouré de trois autres gamins qui vivaient à peu près la même chose que lui. Et ces quatre là sont devenus la terreur du quartier. Arrogants et violents, ils s’en prenaient à nous parce qu’ils ne pouvaient pas s’en prendre à leurs parents ; nous étions devenus des substituts sur qui ils pouvaient passer leur rage.
J’avais à l’époque une chienne qui se nommait «Dolly». Une adorable bête d’une douceur extrême. C’était un mélange de tous les bâtards de Roseville. Mais bon sang ce qu’elle était intelligente ! Je l’adorais. Un jour, mon père a déclaré que Dolly allait être maman et quelques semaines plus tard, six magnifiques petits bâtards on vu le jour dans le panier de la chienne. Je m’en souviens très bien: il y en avait deux noirs avec un peu de marron sur la pointe des oreilles, les autres étaient tous beige. Ils étaient si mignons ! Potelés, et tellement patauds. Ils tremblaient quand ils essayaient de se tenir sur leurs pattes.
Mon père m’a demandé d’avertir mes copains que nous aurions des chiots à donner dans quelques semaines, quand ils seraient sevrés et que Dolly leur aurait appris les bonnes manières.
Tous en voulaient un, mais il leur fallait l’accord de leurs parents. Et ils voulaient les voir ! Alors, un samedi après-midi, je suis sorti de la maison, escorté par Dolly, en portant fièrement son panier dans mes bras. Les chiots semblaient heureux de découvrir un nouvel environnement. Il faisait beau et chaud.
Mes amis m’attendaient devant le terrain vague et mon arrivée a été un véritable triomphe. J’avais l’impression d’être une star ! Tout le monde était penché au-dessus du panier et nous caressions les chiots du bout des doigts. Dolly nous tournait autour et remuait de la queue comme jamais. Les chiots poussaient des petits cris et nous mordillaient le bout des doigts. Tout le monde riait et chacun savait lequel il prendrait, s’il en avait l’autorisation.
Tout à notre affaire, nous n’avons pas entendu Bruce et ses acolytes arriver. C’est quand il nous a lancé: «Alors, bande de lopettes, vous faites quoi tous accroupis comme ça ?» Il n’avait pas encore vu les chiots. On s’est tous relevés et quand il a fini par apercevoir le panier et son contenu, son visage a changé. Je crois bien que pendant un bref instant, à la vue des chiots, Bruce était redevenu celui qu’il était quand tout allait bien chez lui. Mais ça n’a pas duré… son expression est redevenue si dure. « C’est à toi Josh ?
– Oui. C’est les petits de Dolly. Tu en voudras un ? Ils seront disponibles dans quelques semaines, quand ils seront sevrés.
– Pourquoi pas ? »
Bruce s’est penché au-dessus du panier, il a caressé les petites têtes et a délicatement soulevé un des chiots noir. Il s’est redressé et a fait semblant d’examiner la petite bête : «Je prendrais bien celui-là, il a l’air sympa… Mais tout compte fait… Non. Je n’en veux pas de ta saloperie de moule à crotte !» Et en ayant dit ça, il a violemment jeté le chiot sur le sol dur et il a éclaté de rire ! Tu te rends compte John ? On était tous pétrifiés d’horreur. La pauvre petite créature innocente était morte sur le coup. J’ai remarqué que ses potes avaient été surpris, eux aussi et qu’ils affichaient une moue de dégoût, un profond malaise.
Bruce nous a observés en riant, les mains sur les hanches et il s’est adressé à Samantha: «Tu pleures Sam ? T’en as gros sur le cœur ? Pourtant, il me semble que c’est bien plat là-dessous…» En désignant du doigt sa poitrine naissante, il a approché sa main dans l’intention de tâter à travers son débardeur, mais Sam a attrapé un bâton au sol et s’en est servi pour le menacer: «Ne t’amuse pas à ça Bruce ! Ou je te jure que je te fends le crâne !
– Ok. Ok ma belle… Plus tard, tu verras, plus tard…»
Et Bruce est reparti en ricanant, les pouces coincés dans les poches de son jean, suivi par ses sbires, penauds, honteux et la tête basse.
Dolly a reniflé son petit inanimé, recouvert de sang et de poussière. Elle a tenté de le remuer du bout de son museau en pleurant. On pleurait tous avec elle.
Quand je suis rentré à la maison, après avoir enterré le petit cadavre, le panier dans les bras, j’avais toujours des larmes qui coulaient le long de mes joues. Quand ma mère m’a vu dans cet état, elle s’est affolée et a appelé mon père. Je leur ai raconté ce qui s’était passé. Mon père n’a rien dit. Il est sorti. J’ai su plus tard qu’il s’était immédiatement rendu chez les Scott. Ça ne s’était pas bien passé car les parents de Bruce étaient très alcoolisés et agressifs. Le père de Bruce avait essayé de frapper le mien, mais n’avait pas réussi à l’atteindre ; par contre, il s’était pris en retour un uppercut dans le menton et il était rentré chez lui à reculons en faisant des moulinets avec ses bras, pour s’affaler sur la table basse du salon recouverte de bouteilles. La mère de Bruce s’était alors transformée en sirène d’alarme et avait alerté tout le quartier.
La police était intervenue, et en constatant l’état de la maison et la dépendance alcoolique des Scott, les agents avaient fait appel aux services sociaux.
On n’a jamais revu Bruce après cette journée. Il avait été enlevé à ses parents et placé dans une famille dans un autre état.
Ce soir-là, avant de m’endormir, toujours en larmes, j’ai prié, John. J’ai prié comme un petit garçon submergé par le chagrin peut le faire… J’ai demandé à Dieu et à ses anges de punir Bruce pour ce qu’il avait fait. Je n’avais jamais prié comme ça avant ce jour ; et ça ne m’est pas arrivé depuis.
Je sais qu’après ça, il a très mal tourné… Il a fait de la prison et en est ressorti pour disparaître totalement.
– Quel salopard !
– C’est vrai John, il est devenu un véritable monstre. Mais, tu sais, il n’était pas comme ça avant. S’il avait pu évoluer, assuré de l’amour de sa mère, avec un père en qui il aurait pu trouver un modèle à qui s’identifier, tout ça ne serait jamais arrivé. Il serait devenu un type normal. Un père de famille sans doute… Et ce serait resté un ami.
– Tu lui trouves des excuses, mais il y a d’autres gars qui ont eu une enfance épouvantable et qui ont malgré tout évolué dans le bon sens…
– Oui, mais Scott était probablement un garçon fragile. Il n’avait pas suffisamment de force pour supporter ce qu’il a dû endurer. L’amour est à la base de tout. Sans amour, les hommes deviennent des bêtes. Tout est là… As-tu de l’amour John ? Si tu t’étais retrouvé dans les mêmes circonstances quand tu avais dix ans, comment aurais-tu réagi ? Peux-tu affirmer que tu n’aurais pas suivi le même chemin ? Je ne crois pas.
– Quand même…
– C’est la souffrance qui l’a rendu fou ; comme ces soldats qui reviennent du front et qui en ont trop vu. Quelque chose en eux s’est cassé, et ce n’est pas réparable.
– Soit. Et peux-tu enfin me dire comment il est mort ?
– Oh ! Ça… Je pense que tu n’es pas encore prêt pour l’entendre John. Je crois que tu devrais d’abord te renseigner sur les disparitions à Roseville dans les années quatre-vingt. En fonction de ce que tu découvriras et de tes conclusions, je verrai si nous sommes disposés à te dévoiler la vérité.
– Nous ?
– Pardon… Je. »
John a quitté le pénitencier la tête remplie de questions, en proie à une perplexité gênante. En prenant place au volant de sa voiture, il a pris conscience du temps en regardant sa montre: «Merde ! Je suis parti deux heures.»
Au journal, Marshall l’attendait, inquiet. En l’apercevant, il est sorti de son bureau vitré et lui a fait un geste de la main: «Hanlon ! Venez, s’il vous plaît.» John l’a rejoint et Marshall a refermé la porte derrière eux: «Bon sang ! John ! Où Diable étiez-vous passé ?
– J’étais à Cranston, au pénitencier.
– Au pénitencier ? Pourquoi ?
– J’avais besoin d’éclaircir certaines choses avec un des détenus que j’avais rencontré lors de mon enquête sur l’établissement.
– Et ça ne vous serait pas venu à l’esprit de prévenir quelqu’un ?
– Désolé, mais je ne pensais pas que ça durerait aussi longtemps…
– Mouais… Et ça valait le coup ?
– Je crois, mais je n’en suis pas certain… Il faudra que j’y retourne bientôt.
– Un rapport avec la façon de travailler de Taggart ?
– Non. Rien à voir. C’est au sujet d’une affaire des années quatre-vingt.
– Vous me rassurez ! Vu votre façon de mener vos enquêtes, j’ai craint pour la réputation du directeur…
– Patron, si j’avais eu l’intention de mener une enquête sur lui, vous en seriez déjà informé et je vous aurais demandé votre avis.
– OK. OK. Et votre enquête, là, ça va faire du bruit ?
– Non. C’est plutôt personnel. Mais c’est important.
– Que cela ne vous empêche pas de faire le travail pour lequel on vous paie, hein ? Allez ! Au boulot ! »
Le reste de la journée s’est déroulé normalement. On lui a confié une enquête sur un projet de construction d’un nouveau complexe commercial qui s’annonce grandiose et disproportionné à Providence. Encore une affaire de gros sous qui demandera de la discrétion et du tact…
Une fois rentré chez lui, seul, John a pris un soda dans le réfrigérateur et il s’est installé devant son portable ; il a ouvert son moteur de recherche et tapé «disparitions à Roseville». Une multitude d’articles sont apparus qui traitaient de disparitions d’enfants et de femmes entre quatre-vingt deux et quatre-vingt cinq. Une vingtaine au total. Et malgré les recherches, aucun des disparus n’a jamais été retrouvé. En lisant un des articles, John a repéré parmi la liste des disparus une Samantha King, célibataire et institutrice à Roseville. Pour illustrer l’article, il y avait une photographie du groupe qui participait aux recherches. Sous la photo, en tout petit, figuraient les noms des participants et… Bruce Scott en faisait partie !
John a zoomé cette partie de l’article et l’a imprimée en haute qualité, en couleur sur son imprimante laser. Il a ensuite tapé Bruce Scott sur son clavier et différents articles se sont affichés dont un comportant une photo d’identité de l’intéressé. Il avait des cheveux en aile de corbeau, des yeux cruels et un air provocateur.
En comparant la photo imprimée à celle de l’écran, John a pu repérer Bruce au milieu du groupe. Il était le seul à sourire au photographe. John s’est adossé contre le dossier du fauteuil et a porté ses mains sur son crâne: «Merde ! Il était là ! Sam avait disparu, il la cherchait et il souriait !
Les disparitions avaient cessé après sa mort… Pure coïncidence ? Non. Josh savait ! Il était retourné à Roseville après la mort de sa femme et, quand les disparitions avaient commencé à se produire, il avait dû comprendre que Bruce Scott était derrière ces crimes. Mais, comment avait-il pu savoir ? Qui d’autre savait ? Qui l’avait informé ? Un de ses anciens amis ?
John a saisi son téléphone portable pour appeler le pénitencier et ensuite, il a appelé son patron pour le prévenir qu’il aurait du retard le lendemain.
Il a ensuite imprimé tous les articles qu’il jugeait intéressants et il les a rangés dans une chemise à rabats. Au feutre noir épais, il a inscrit sur la pochette «JOSH».
Quand Anna est rentrée, elle a trouvé John assis à son bureau, la tête entre les mains.
– Un problème, chéri ?»
John a sursauté et il a émergé, laissant brutalement ses cogitations au fond de son esprit, pour un temps. Il a souri à son épouse: « Non. Pas de problème. Une énigme plutôt. Un condamné pour meurtre qui n’a tué personne et qui a assisté au meurtre.
– Il a été condamné alors qu’il n’est pas coupable ?
– C’est ça.
– Comment la victime a-t-elle été tuée ?
– Personne ne le sait.
– Tu plaisantes !
– Non. Et je crois que la victime était un tueur en série, un dingue que connaissait le condamné.
– Une histoire à dormir debout…
– Oui. Elle m’obsède et m’empêche de dormir.
– Mon pauvre chou ! Et tu comptes écrire un article là-dessus ?
– Je ne sais pas… Ça ne dépend pas de moi.
– Ah bon ! Et ça dépend de qui ?
– De Josh…
– C’est qui ?
– Le témoin du meurtre qui croupit dans sa cellule depuis trente ans et qui ne veut pas en sortir. Voilà qui c’est ! Et…
– Et ?
– Et c’est devenu mon ami.
– Ton ami ? Tu l’as vu souvent ?
– Deux fois.
– Tu as rencontré ce type deux fois et il est devenu ton ami ?
– C’est ça. Aussi improbable que cela puisse paraître, j’éprouve de la sympathie pour lui. Et je sais qu’il m’estime.»
Anna s’est accroupie près de John et a pris sa main. «J’ai l’impression que cette histoire te bouleverse mon chéri. Pourquoi ?
– Je sens qu’il y a autre chose derrière tout ça. Quelque chose qui me dépasse. Je ne sais pas quoi, mais j’en aurai bientôt le cœur net.
– Je sais comment te changer les idées… Suis-moi dans la chambre, ou sur le canapé si tu préfères. Allez, viens mon chou… Et sois à ce que tu fais. »
John n’a pas réussi à fermé l’œil de la nuit. Il n’a pas cessé de retourner toutes ses informations dans tous les sens ; et il a eu beau imaginer tous les scénarii possibles, il n’arrive toujours pas à trouver une solution cohérente. Il lui manque un élément. Une information capitale. Et seul Josh la détient.
A cinq heures du matin, n’y tenant plus, il se lève en silence, prend ses vêtements et file discrètement jusqu’à la salle de bains. Après sa douche, il se rase de près et s’habille pour ensuite se préparer un café noir, très fort. Après l’avoir bu et pris connaissance des dernières nouvelles sur le Net et à la télévision, il quitte l’appartement et prend la route en direction de Cranston City. A cette heure, les routes sont presque désertes et la lumière du matin est un véritable enchantement. Les kilomètres défilent et John roule lentement, il n’a pas besoin de se presser car il est en avance.
En arrivant à Cranston City, John se gare devant le Al-Mall’s Restaurant et en franchit le seuil pour commander un petit déjeuner. Pour l’instant, il n’y a que trois autres clients, le nez plongé dans leur journal. Le café fume au-dessus des tasses et les employés travaillent lentement, discrètement, prenant leur temps avant de retrouver leur rythme de croisière qui s’imposera quand, dans quelques minutes, le restaurant sera rempli.
Tout en mangeant, John observe la rue qui s’anime maintenant. Le restaurant se remplit et le brouhaha des conversations comble bientôt le silence qu’il avait apprécié en entrant.
Pour la troisième fois, John se retrouve seul dans le petit local de la prison. Il est intérieurement excité, mais détendu. Il s’assied sur un coin de la table, et attend Josh qui ne devrait pas tarder à arriver.
La porte s’ouvre et un gardien apparaît, la mine contrariée : « Monsieur Hanlon ?
– Oui. J’attends Josh Barett. Arrive-t-il bientôt ?
– Eh bien… Justement, Josh a eu un malaise ce matin. Il aurait eu un problème cardiaque.
– Oh non… Il est parti à l’infirmerie ?
– Non. Il a refusé. Il souhaite rester dans sa cellule et il demande à ce que vous veniez l’y rejoindre.
– Dans sa cellule ? Je vous suis. Est-ce que son état est critique ?
– Je n’en sais rien, je ne suis pas médecin… Sinon, je ne travaillerais pas ici et je conduirais une Porsche à la place de mon tas de ferraille.»
La cellule est ouverte et Josh est allongé sur son lit, raccordé à un scope qui ne cesse de débiter des bips rapprochés, censés rassurer ? Un masque en plastique et transparent est maintenu sur son visage par un élastique, et une bouteille d’oxygène a été déposée près de lui.
– Josh ? Qu’est-ce qui t’arrive ?
– Le carburateur qui a des ratés, je crois. Dis-leur de nous laisser seuls et prends la chaise… On doit parler. Avant que je ne puisse plus le faire.»
John demande au gardien de sortir et de les laisser. Ce qu’il fait. Et quand ils sont seuls, il s’assoit près de Josh.
– John, J’ai su que tu étais quelqu’un de bien dès que je t’ai parlé. J’aurais aimé te connaître plus tôt ; et si j’avais eu un fils, j’aurais voulu qu’il te ressemble… Alors, dis-moi, qu’as tu découvert ?
– J’ai compris que Bruce était le responsable des disparitions à Roseville dans les années quatre-vingt. J’ai trouvé la photo du groupe de recherche pour Samantha et il était dessus, il souriait. Je sais que tu l’avais su toi aussi à l’époque. Je pressens que c’est pour ça qu’il a été tué, pour venger tous ces morts. Et je pense que c’est la mort de Samantha qui t’a décidé, non ?
– Tu es malin, John. Et tu es doué. Mais tu es encore loin du compte…
– M’aideras-tu à comprendre ? Cette histoire m’obsède et je n’en dors plus de la nuit.
– Si je te raconte ce qui s’est réellement passé, tu ne pourras jamais l’écrire. Ou bien tu passeras pour un dingue.
– Je ne suis pas sûr de vouloir divulguer ton histoire. Je veux juste comprendre.
– Ok, ok. De toute façon, ça n’aura bientôt plus d’importance pour moi…
– Allons, Josh ! Ton état n’est pas aussi grave que ça.
– John, approche, écoute… Je t’ai menti. En quatre-vingt-cinq, quand Mary est morte, j’ai à nouveau prié comme je l’avais fait à l’âge de dix ans. Mon Dieu, j’ai prié tellement fort… Je souffrais tant que j’avais l’impression que mon cœur s’était déchiré et que tout mon corps n’était plus qu’une plaie béante. J’avais tellement pleuré ma femme que plus aucun son ne pouvait sortir de ma gorge et mes yeux ne pouvaient plus s’ouvrir comme mes paupières étaient trop gonflées. Je repensais à nos bons moments, mais je ne pouvais oublier mes maladresses, mes lâchetés, mes mensonges aussi. Je souffrais comme un damné et je n’avais plus qu’une envie, la rejoindre là où elle se trouvait. La mort ne me faisait pas peur. Tu comprends ? Elle était passée par là, alors je le pouvais aussi. Et je me sentais coupable d’être encore en vie, ici, alors qu’elle était partie. Et le soir après son enterrement, j’étais allongé sur notre lit, aphone et quasiment aveugle, à espérer la mort pour la rejoindre. Et je me suis mis à prier, prier, prier pour que je puisse la retrouver, l’entendre à nouveau, l’avoir à mes côtés.
Alors que je n’en pouvais plus, que j’en étais à un stade où je pensais que j’allais perdre la raison, ils me sont apparus.
– Qui ça Josh ?
– Ne m’interromps pas. Je suis fatigué… Ils sont apparus devant moi, suspendus dans l’air. Ils étaient nombreux, des petits et des grands. Ils flottaient devant moi et malgré mes paupières fermées, je les distinguais. Ils flottaient gentiment comme des nuages de vapeur qui ne se dissipent pas. Je croyais que j’avais déjà perdu la raison et que je ne la retrouverais jamais. Je m’en foutais car je pensais que dans cet état, je souffrirais moins. Mes doutes sur ma santé mentale se sont aggravés quand l’une de ces apparitions m’a parlé, John. Elle m’a proposé un pacte. Je devais les aider et en échange, Mary viendrait les rejoindre à mes côtés ; jusqu’à la fin de mon existence. J’ai accepté John, j’ai accepté… Et Mary m’est apparue. Elle est venue me caresser le visage comme elle le faisait toujours. Elle m’a même dit: «Ne pleure pas comme un gros bêta, tu vas tremper les draps». C’était son mot pour se moquer de moi, «Gros bêta».
Le pacte était assorti d’une autre clause: je ne devais divulguer leur existence et leur projet à personne, sinon, elles partiraient et je resterais seul jusqu’à la fin de mes jours. Ces formes, ou ces esprits, appelle-les comme tu veux, ce sont les victimes de Bruce. Elles voulaient en finir avec lui et se venger des abominations qu’il leur avait fait subir avant de les tuer et de les enterrer. Alors, j’ai quitté Phoenix et je suis parti pour Roseville, ma ville natale, accompagné par Mary et ses amis, tous invisibles. Je ne les vois que quand nous sommes seuls. Mais ils peuvent me chuchoter à l’oreille comme ils l’ont fait à chacune de nos précédentes entrevues.
Deux jours après notre arrivée à Roseville, Samantha King disparaissait. Bruce avait tenu parole ; il n’avait pas oublié la promesse faite à Sam quand elle le tenait en respect avec son bâton. Alors, je l’ai suivi discrètement et j’ai attendu qu’il se dirige vers le terrain vague, là où nous jouions enfants et où il allait picoler jusqu’à en tomber par terre ; là où il entrainait ses victimes, loin des regards et des oreilles pour les violer, les torturer et les étrangler ou leur défoncer le crâne avec un marteau. Après, il les enterrait dans différents endroits, quand il faisait nuit.
Je l’ai vu sortir de sa voiture en titubant, il était passablement éméché, c’était le début de la soirée. Je me suis garé avant la zone abandonnée et je l’ai rejoint à pied.
Il était assis et ingurgitait du Scotch bon marché à même le goulot. Il avait une sacrée descente… Quand il s’est aperçu de ma présence, il a bien failli s’étouffer avec son tord-boyau ! Il s’est lentement relevé, tanguant sur ses jambes. Il m’a dévisagé durant un bon moment et a réussi à articuler avec difficulté: «T’es qui, toi ?
– C’est Josh, Bruce.
– Josh… Josh qui ?
– Josh Barett, ton pote d’enfance…
– Aaah Josh ! Ouais… C’est ton père qui a fait mettre le mien en cabane ! Et moi, je me suis retrouvé tout seul ! Salauds !
– Non Bruce. Tous tes malheurs, tu les dois à tes propres parents, et à toi-même… Tu as tué un chiot, et tu as ensuite tué des enfants et des femmes, Bruce. Sam ne t’avait rien fait ; et tu l’as tuée. Tu l’as violée, mutilée et tu lui as défoncé le crâne à coups de marteau. Le seul salaud ici, Bruce, c’est toi.»
Il a cligné des yeux plusieurs fois ; sans doute le temps que l’information arrive au bon endroit, à travers les brumes de l’alcool. Il a semblé réfléchir tout en se balançant d’avant en arrière sans tomber.
– Co… Comment tu sais tout ça Josh, hein ? Et puis, je n’ai pas dit que c’était vrai, atten… Attention ! Mais comment tu le sais ? Hein ?
– Elles me l’ont dit, Bruce.
– Qui c’est qui t’a raconté ça ? Hein ?
– Tes victimes. Elles sont là, avec moi. Devant toi. Elles t’entendent et veulent passer un moment avec toi. Un dernier moment. Et je crois que tu ne vas pas tarder à les voir… Adieu Bruce.»
J’ai tourné les talons et je me suis dirigé vers ma voiture. Je l’ai entendu: «Josh ? Qu’est-ce que tu racontes ? Hein ? T’en vas pas mon pote… Hé ! Je suis désolé pour le chiot… Je suis désolé… Oh bordel ! C’est quoi ça ? Hé ! C’est quoi Josh ? N’approchez pas ! Ne me touchez pas ou vous allez le regretter ! Lâchez-moi ! Au secours ! Josh !»
Ce sont ses dernières paroles. Ensuite, il n’y a eu que des cris, des hurlements de douleur et de frayeur. Ça a duré un bon moment… Parfois, dans mon sommeil, je l’entends encore hurler et ça me réveille. Mais Mary est à côté de moi et tout va bien…
Tu sais tout John. Tu comprends maintenant pourquoi, il n’y avait pas d’arme, pas de blessure physique. Elles se sont attaquées à son âme. Et je crois qu’il a souffert l’enfer.
Tu sais aussi pourquoi je n’ai rien dit à personne sur les circonstances de la mort de Bruce. Je devais respecter le pacte pour pouvoir conserver ma Mary près de moi. Et je préfère vivre dans ce pénitencier avec elle, plutôt que dehors seul. Ou encore dans un hôpital psychiatrique où on m’aurait sûrement enfermé. C’était mon choix.
– Des spectres ? C’est bien ça ? Les fantômes des victimes ?
– C’est ça.
– J’ai beaucoup de respect pour toi Josh, mais je dois t’avouer que je ne crois pas à ces choses-là. J’ai l’impression que tu te moques de moi, non ?
– C’est la vérité, John. Tu en fais ce que tu veux. Ça n’a plus aucune importance pour moi car je suis entrain de mourir, mon ami. Je ne vais pas tarder à partir avec eux et poursuivre ma route dans l’au-delà avec Mary… Oooh ! Adieu John… Prends soin de…
Joshua Barett décède d’un infarctus du myocarde à dix heures quinze. A côté de son ami journaliste.
John pleure un long instant et se dit qu’il va devoir avertir le gardien.
Pendant ce temps, il ne peut s’empêcher de penser que son histoire d’amour était belle. Il adorait sa Mary et elle lui manquait. Mais des fantômes vengeurs qui concluent un pacte, vraiment… C’est d’un ridicule ! Il aurait pu trouver mieux ! Et quand il finit par se lever de sa chaise, pour aller prévenir le gardien, John s’arrête tout net. Des formes commencent à apparaître dans la cellule. Elles flottent au-dessus du sol. Il y en a une vingtaine.
John écarquille les yeux, ouvre grand la bouche et sent tous ses poils se hérisser. Il est comme pétrifié par la peur, debout devant sa chaise, raide comme un piquet. Une des formes vaporeuses se détache du groupe et s’approche lentement de lui ; et quand elle est tout près, il entend distinctement un chuchotement : «Je ne t’ai pas menti John… Tu comprends ? On va partir. Réfléchis bien avant d’écrire quoi que ce soit là-dessus… Ta réputation, John. Les journalises sérieux n’écrivent pas ce genre de chose… Dans mon matelas… Trouve la carte de Roseville… Envoie-la au Sheriff… Il doit creuser aux endroits marqués d’une croix rouge… Il y trouvera les corps des disparus. Adieu…»
Et les formes disparaissent subitement.
John reprend son souffle tout à coup et hurle à pleins poumons. Le gardien accourt et lui demande ce qui lui prend de crier comme ça. Et tout ce qu’il peut répondre c’est: «Josh est mort». Le gardien lui tape sur l’épaule et lui répond: «Oui. C’est quand même triste. Ça va ? Vous faites une drôle de tête, on pourrait croire que vous avez vu un fantôme…»